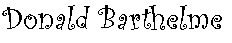
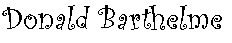
J'ai l'impression que l'oeuvre de Donald Barthelme est de celles qui secouent toute la littérature sur ses fondations. Je dis « j'ai l'impression », car les gens qui pensent comme moi sont rares.1 : même les admirateurs de Barthelme se contentent généralement de le présenter comme un auteur « amusant ».
Tout d'abord, Barthelme est pour moi l'inventeur d'une nouvelle forme littéraire : une sorte de nouvelle (story) ultra-courte, fermée sur elle-même, avec un style et une thématique propre. Cette forme littéraire me paraît bien adaptée au goût des lecteurs modernes : on aime la littérature expérimentale, mais pas sur des centaines de pages. Cette forme ne résulte peut-être pas d'un choix : peut-être était-elle imposée par la revue The New Yorker, dans laquelle Barthelme publiait ses textes. Je ne le crois pas, cependant : ses romans The King et Snow White sont construits comme des collections de stories du même format. Il n'y a entre les chapitres qu'une unité de thème et quelques personnages communs : le style, lui, change à chaque fois.
Une nouvelle forme littéraire ? Pas sûr : quand je lis Barthes (les Fragments d'un discours amoureux, par exemple), j'ai aussi l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle forme littéraire, différente. Quelque chose entre la nouvelle, l'essai, et le poème en prose. Mais non pourtant : vingt ans après sa mort, plus personne n'écrit comme ça (à moins de compter La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules (Delerm), comme un exemple de ce genre-là.) Barthes, pas plus que Barthelme, ne semble donc avoir créé un nouveau genre littéraire. Il semble que l'on soit condamné à tout jamais à ne connaître la fiction que sous deux formes : la nouvelle et le roman.
Pour revenir à la nouvelle de Barthelme, on a à première vue l'impression de lire un exercice de style : questions-réponses, compte rendu militaire, commentaire de collages surréalistes, conversation téléphonique, etc. Mais dans un exercice de style (chez Queneau par exemple) il y a une clef unique : une fois qu'on l'a trouvée, le texte n'a plus de mystère. Ce n'est pas du tout le cas chez Barthelme. Barthelme remet en cause ce qui est peut-être le dogme le plus fondamental de l'esthétique littéraire (et pas seulement littéraire), à savoir l'adéquation de la forme et du fond. Chez lui, la forme est toujours en décalage par rapport au fond.
Le compte rendu militaire, par exemple, parle de Paul Klee. Pourquoi Paul Klee ? Tout est comme ça : le texte est saturé de clins d'oeil, d'allusions plus ou moins érudites, mais aucune ne semble avoir de sens. Au milieu d'un jeu formel purement gratuit, soudain, une réflexion étrangement grave sur le sexe, la mort ou la société du spectacle. Rien de plus déstabilisant qu'une lecture de Barthelme : c'est un défi permanent au lecteur.
Alors, est-ce que tout ça ne veut rien dire ? Non, Barthelme a une thématique propre passionante, mais pas facile à découvrir, étant donné l'incohérence de l'oeuvre. Cette thématique, je l'ai découverte dans des notes de cours trouvées sur internet. Je vous la livre telle que je l'ai comprise. Barthelme parle du choc entre la culture et la vie quotidienne : comment le poids de la culture brouille notre vision de la réalité, la déforme, l'étire, jusqu'à la cassure. Dans Snow White : il y a deux visions contradictoires du nain dans la culture populaire : le nain-enfant, asexué, gentil, le nain de Walt Disney et des pavillons de banlieue, d'une part, et le nain hypersexué, pervers : comme Toulouse-Lautrec. Dans le texte, les deux stéréotypes du nain empêchent de lire le texte au premier degré. Finalement, si on rencontre dans la vie réelle un vrai nain, est-on immunisé contre ces préjugés ? La collision entre la réalité et la culture peut avoir des effets tout à fait surprenant : The King raconte l'histoire du Roi Arthur (l'archétype même du Roi) transposée pendant la seconde guerre mondiale. Arthur est à la tête du royaume, et Churchill est son premier ministre. Pendant un moment on pense : quelle idée, un Roi à la tête de l'Angleterre, quel stupide anachronisme ! Jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y avait réellement un Roi à la tête de l'Angleterre pendant la seconde guerre mondiale...
La Bibliothèque de Babel, de Borges. Barthelme partage avec Borges la vision d'une culture écrasante, labyrinthique, dans laquelle on se sent perdu. A défaut d'autre chose, la Bibliothèque de Borges est bien rangée. Celle de Barthelme a pour ainsi dire explosé, et ses morceaux se retrouvent éparpillés un peu partout. Pas seulement la Bibliothèque de Babel, d'ailleurs, mais aussi sa vidéothèque, son zoo, son sex shop, ses fast foods et son musée : un vrai capharnaüm.
Pour en savoir plus... (Webographie). Peu de choses en français sur Barthelme. En anglais, il y a essentiellement le site Bathelmismo. On y trouve quelques textes en ligne, une bibliographie complète (ce qui n'est pas si évident car beaucoup de ses livres n'ont pas été réédités).